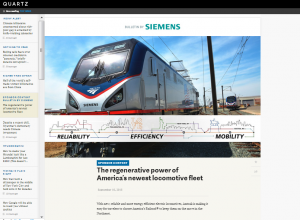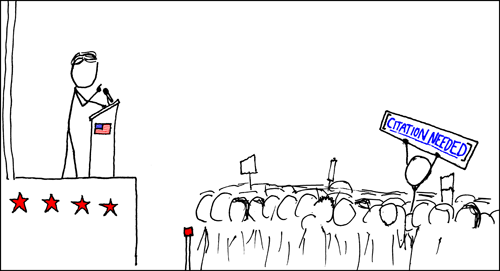Vous n’étiez pas au Festival international de journalisme de Pérouse la semaine dernière, et vous avez bien fait. Il y avait beaucoup trop de conférences intéressantes en même temps, ça rend le choix impossible et on finit la journée avec un super mal de crâne, après avoir subi un tel flot de bonnes idées, de conseils utiles et d’expériences passionnantes.
Et puis c’est totalement gratuit, alors les salles sont bondées, remplies d’étudiants en journalisme et d’activistes sans le sou, merci bien. Quant aux intervenants, c’est bien simple : ils répondent aux questions, débattent avec le public, sont ouverts aux critiques et accessibles même le soir, au restaurant. Tant de démagogie, c’est fatiguant.
Enfin, j’ai pensé à vous et j’ai fait une petite compilation de phrases que vous pouvez ressortir dans les dîners entre journalistes, pour faire croire que vous y étiez.
1. « Tu sais, si tu chasses les clics, tu finis par publier des chatons »
Comme le blogueur Jeff Jarvis, auteur de cette formule pendant sa keynote, beaucoup d’intervenants ont rappelé que les médias devaient mieux choisir les statistiques à suivre pour bien développer leur site :
« Les métriques doivent être repensées. Les pages vues, les visiteurs uniques, le nombre de likes… tout ça, c’est du passé.
Avec Chartbeat, on peut mesurer le temps passé sur le site, et vendre aux annonceurs du temps d’affichage de leurs publicités [et non un nombre d’affichages, ndlr]. Ça va dans la bonne direction, mais ça aussi, je pense qu’on pourra le truquer.
Il faut aller vers des mesures plus qualitatives, pour savoir si ce que les journalistes font a vraiment de la valeur, comprendre ce qu’ils apportent à la vie des gens. Je ne sais pas comment on peut mesurer ça, mais il faut trouver. »
Même constat pour Stijn Debrouwere, spécialiste des statistiques des sites de médias, dont la conférence était pleine de bons conseils – je l’ai d’ailleurs retranscrite.
2. « Il faut casser les services et travailler en équipe »
D’accord, il y aura toujours des rédacteurs de génie et des enquêteurs hors pair qui bossent en solo, se contentant d’envoyer un fichier Word par e‑mail une fois leur tâche terminée.
Mais pour tous les autres, être capable de bien travailler dans des équipes mêlant des métiers de plus en plus variés devient un impératif.
Aron Pilhofer a ainsi raconté qu’à son arrivée à la tête du numérique au Guardian, il s’est ainsi empressé de créer un pôle « Visuals », regroupant des compétences en photo, en illustration, en design, en multimedia… Une idée empruntée à la NPR, le réseau américain de radios publiques :
« Avant ça, ces métiers étaient plus ou moins dans des services séparés. Ça n’a pas de sens : quand vous montez un projet numérique, ça implique forcément du texte, des images, de la vidéo, des graphiques, des animations…
Vous ne devriez pas avoir à négocier entre les différents services pour former votre équipe. C’est quelque chose qui était vraiment difficile pour moi quand j’étais au New York Times et dans d’autres rédactions.
Ça oblige à mener des négociations dignes de pourparlers à ONU, en allant voir chaque responsable pour le convaincre de l’intérêt de votre idée. Ça prend un temps fou, ça se termine avec une réunion avec quarante personnes dans la pièce, et ce n’est pas comme ça qu’on fait du bon journalisme. »
Qu’ils le veuillent ou non, les médias ne sont plus seulement des fournisseurs de contenu, mais aussi des créateurs de technologie. Et seuls ceux qui peuvent monter rapidement des équipes pluridisciplinaires seront à même de mener des projets rédactionnels ambitieux sans les voir s’enliser.
3. « L’Afrique mérite mieux que le journalisme-hélicoptère »
Trouver des solutions africaines aux problèmes africains : l’adage vaut aussi pour les médias, à en croire le journaliste et poète Tolu Ogunlesi. Basé à Lagos, au Nigéria, il en a assez de voir des reporters de télés occidentales débarquer dans un pays pour couvrir une crise pendant quelques heures, avant de repartir pour toujours :
« J’appelle ça le “journalisme-hélicoptère”. Les médias locaux, eux, sont là sur la durée. Depuis quelques années, les journalistes africains ont gagné en confiance, assez pour raconter leur propre expérience. Les réseaux sociaux ont permis à leur voix de porter davantage.
Avant, CNN ou la BBC étaient les seuls à avoir les moyens de dominer la conversation mondiale, maintenant on a des chaines comme Channels au Nigeria qui a très bien traité les récentes élections.
Quand vous parlez de l’endroit dans lequel vous vivez, où se trouve votre maison, vous pouvez vous permettre d’aller plus loin, d’être plus nuancé. »
4. « Recruter un abonné pour son journal, ce n’est pas seulement lui prendre son argent »
Fini le temps où on pouvait faire signer un chèque ou un formulaire de prélèvement automatique à son lecteur et puis partir en courant, en espérant qu’il reste fidèle pour les dix ou vingt ans à venir. C’est ce qu’a rappelé Jeff Jarvis dans sa keynote :
« Les gens veulent désormais qu’il y ait une vraie collaboration entre leurs médias et eux. Un sentiment d’appartenance, un engagement à faire des choses ensemble. […]
Il faut trouver de nouvelles façons de contribuer, pas seulement en envoyant de l’argent, mais en faisant un effort, en proposant du contenu, de l’aide pour le marketing, des lignes de code, bref tout ce qui peut aider dans notre mission d’informer.
Et en retour, il faut trouver comment récompenser cette participation, et ça ne peut pas être seulement l’accès à un contenu. Ça peut être une invitation à un événement, mais aussi une forme de reconnaissance sociale. »
Alors que beaucoup de sites d’actualité peinent à définir ou rendre attractives leurs offres d’abonnement, c’est peut-être cherchant des « membres actifs » ou des « soutiens » plutôt que de simples « abonnés » qu’ils réussiront. La méthode a en tout cas réussi pour Mediapart.
5. « Le nouveau datajournalisme, c’est le journalisme de capteurs »
On pourrait penser que les cigales sont toujours dans le coin, qu’il suffit de s’installer dehors pour l’apéro pour commencer à les entendre. Mais il en existe un genre particulier, la magicicada Brood II, qui ne débarque sur la côte est des Etats-Unis qu’une fois tous les dix-sept ans.
Pour prévoir le moment exact de son arrivée et ne pas la rater, l’émission Radiolab a lancé début 2013 le projet Cicada Tracker, et proposé aux internautes motivés d’assembler un boîtier électronique capable de mesurer la température à 20 centimètres sous la surface du sol, grâce à un capteur de température.
Des diodes lumineuses indiquent quand la température atteint 17,8 °C, soit juste avant le réveil des cigales mâles, qui rejoignent la surface et commencent à faire du boucan pour attirer les femelles. Les données étaient ensuite centralisées pour dresser des cartes nationales.
Si vous avez envie de tester ça dans votre garage afin de vous préparer pour la vague de 2030, le fabricant Arduino propose toute une gamme de supports qu’on branche à son ordinateur et sur lesquels se montent des capteurs de température, de son, de vent, d’humidité, d’accélération, de lumière, de proximité, de rythme cardiaque, de tension artérielle…
Tous ces produits (présentés par la creative technologist Linda Sandvik à Pérouse) sont loins d’être nouveaux mais, un peu comme les drones, ils ouvrent de nouveaux horizons aux journalistes et aux activistes bidouilleurs. Comme ces étudiants chinois qui ont fait voler des cerf-volants pour mesurer la pollution dans le ciel chinois.
6. « Aujourd’hui, tu peux plus te contenter d’être un observateur, il faut t’engager »
Le journaliste est de moins en moins vu comme un pur esprit, observateur objectif de la marche du monde mais ne prenant jamais part aux événements qui le secouent.
Ce mythe-là a vécu, comme l’a prouvé la récente initiative du Guardian, qui veut faire pression sur la fondation Bill et Melinda Gates et d’autres fonds d’investissement afin qu’ils n’investissent plus dans les entreprises exploitant les énergies fossiles, afin de lutter contre le réchauffement climatique.
Une vraie libération pour Aron Pilhofer :
« Après vingt ans de journalisme, je m’étais toujours arrêté devant cette porte-là. On est là pour raconter ce qui se passe, ce qui ne va pas, ce qu’il faudrait faire, mais on ne s’empare pas d’un combat. Et ça, c’est vraiment frustrant à force.
Ce serait impossible de faire ça au New York Times, ils ne veulent vraiment pas aller vers un « journalisme de solutions. »
Beaucoup de projets reposent aussi sur la collaboration avec des organisations non gouvernementales (ONG) ou des groupes d’activistes, comme le lancement de la revue Alter-mondes, en France.