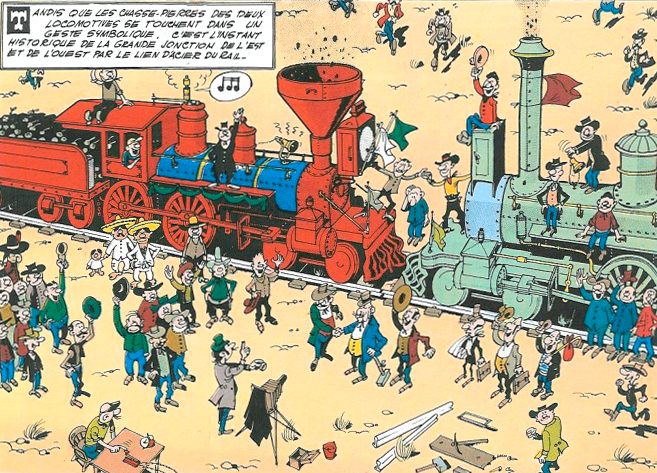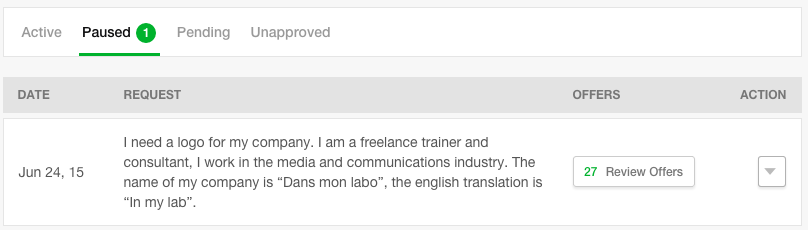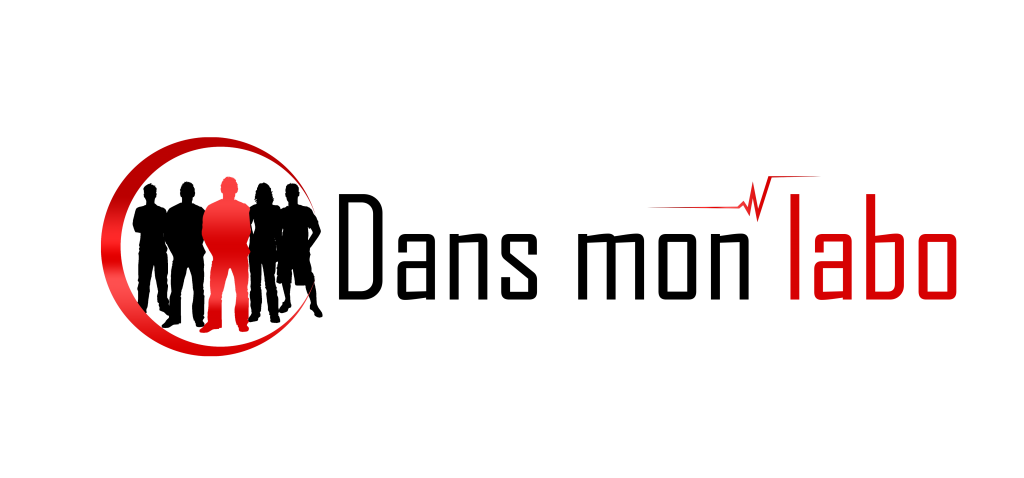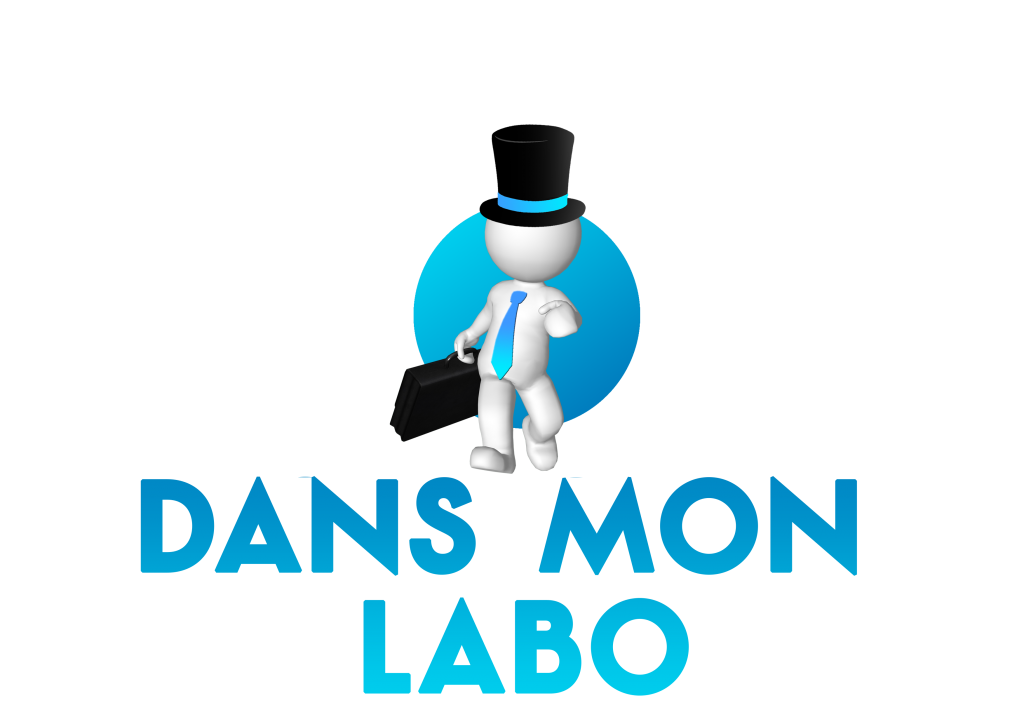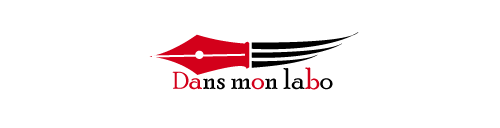« Cette campagne aura au moins eu le mérite de me permettre de faire le ménage dans mes « amis » Facebook. J’en ai viré plusieurs, c’était plus possible de débattre avec eux. » Depuis le premier tour de la présidentielle, j’ai croisé des statuts de ce type plusieurs fois sur ma timeline.
Je comprends tout à fait ceux qui souhaitent se préserver du climat de tension et d’agressivité régnant sur les réseaux sociaux, mais je pense que c’est une très mauvaise idée, particulièrement si vous êtes journaliste. Et dans ce deuxième épisode de ma série consacrée au « journalisme en empathie », je vais tenter de vous expliquer pourquoi.
La présence de Marine Le Pen au second tour, même si elle semble avoir peu de chances de l’emporter, résonne comme un écho étouffé de la victoire des partisans du Brexit au Royaume-Uni et de celle des supporteurs de Trump aux Etats-Unis.
Dans tous les cas, il est tentant pour les médias de rejeter la faute sur les autres : les algorithmes de Facebook et leur appétit pour les fake news ; les politiciens inefficaces, coupés de la société, menteurs voire corrompus ; la cyberpropagande et les hackers du Kremlin…
« Les journalistes britanniques n’ont pas assez parlé aux gens »
Mais c’est aussi dans leur miroir que les journalistes doivent chercher les responsables de ces résultats qui font vaciller nos démocraties représentatives sur leur base.
C’est en tout cas l’avis d’Alison Gow, qui se confiait lors d’un panel du Festival international de journalisme de Pérouse, début avril.
« La bataille pour le Brexit, nous l’avons perdue il y a vingt ans, quand nous avons commencé à ne plus faire notre travail sur les sujets européens », a commencé par expliquer la responsable de l’innovation au groupe Trinity Mirror, dont les tabloïds ont soutenu le camp du « Remain » :
« Comme ce sont des questions compliquées, nous nous sommes réfugiées dans une attitude très britannique qui consiste à se moquer de ce qu’on ne comprend pas. »
Au-delà de cette focalisation sur des histoires triviales comme la régulation de la courbure des bananes, Gow estime surtout que les journalistes « n’ont pas suffisamment parlé aux gens » :
« Nous n’avons pas assez cherché à savoir ce qu’ils pensaient et ce qu’ils avaient sur le cœur. Si on s’était davantage emparés du débat, on aurait pu faire une différence. On est trop restés enfermés dans nos rédactions et dans nos réseaux sociaux. »
« J’aurais dû davantage suivre mon instinct »
Autre panel, même conclusion pour Maria Ramirez, qui a couvert la campagne de Trump pour le groupe Univision :
« Il faut faire davantage confiance à ce que remarquent les reporters sur le terrain et moins à ce que disent les sondages.
J’avais déjà couvert d’autres campagnes, mais en me rendant dans les meetings de Donald Trump, j’ai découvert quelque chose de nouveau : des gens qui ne se seraient jamais déplacés pour un homme politique avant, une atmosphère différente, plus agressive. J’aurais dû davantage suivre mon instinct. »
Ce besoin se reconnecter avec l’audience, Mandy Jenkins, responsable éditoriale de l’agence Storyful, est bien placée pour le ressentir. Native de l’Ohio, elle voit en effet tous les grands médias américains se ruer dans sa région une fois tous les quatre ans – l’Etat est l’un des swing states, ceux dont le vote peut faire basculer l’élection présidentielle :
« Les journalistes mangent les spécialités locales, parlent des gens qui ont des problèmes comme les agriculteurs ou les métallos, se moquent des ploucs.
Mais ils ignorent les secteurs économiques dynamiques et échouent globalement à raconter ce qui s’y passe vraiment. Ils tombent dans la caricature parce qu’ils ne sont pas d’ici. »
« C’est peut-être mieux d’embaucher quelqu’un qui vit dans l’Ohio pour parler d’Ohio »
Pourtant, pour Jenkins, cet éloignement entre les médias et leur public n’a pas toujours été la règle :
« Au niveau local, les gens avaient l’habitude de connaître ou au moins de rencontrer de temps en temps les journalistes qui parlaient d’eux. Ils étaient allés dans la même école, vivaient dans la même ville, fréquentaient les mêmes lieux de vie.
Ce n’est plus le cas aujourd’hui. les journalistes se retrouvent parachutés là où se passe l’actu, et une fois l’actu passée, il n’y a pas de raisons pour eux de rester. »
La concentration s’est en effet accélérée ces dernières années : 13% des journalistes américains travaillent dans le seul quartier de Manhattan, à New York. Trop souvent, les rédacteurs en chef ont peur de ne pas pouvoir contrôler un journaliste s’il travaille à distance, ajoute Jenkins :
« Il aura fallu le plantage de Trump pour qu’enfin, ils se disent, c’est peut-être mieux d’embaucher quelqu’un qui vit dans l’Ohio pour parler de l’Ohio [ou au moins dans un Etat proche, ndlr]. En plus, ça nous reviendra moins cher. »
25 pro-Trump et 25 pro-Clinton dans un même groupe Facebook
Et en France ? Si Marine Le Pen remporte finalement la présidentielle, le défi principal pour les médias généralistes ne sera pas de se prendre pour L’Huma clandestine en entrant en résistance contre le fascisme, mais bien de renouer le lien avec une population qu’ils ont trop souvent exclue de leur radar.
Et l’on aura, nous aussi, le genre de débats qui agitent aujourd’hui les médias britanniques et américains. Une fois (un peu) remis du choc initial, ils ont multiplié les expériences journalistiques sur ce sujet :
Fin 2016, l’ONG Spaceship Media a par exemple rassemblé pendant un moins dans un même groupe Facebook 25 supportrices de Trump vivant en Alabama (considéré comme un des Etats les plus conservateurs) et 25 supportrices de Clinton vivant en Californie (Etat progressiste par excellence).
Non seulement la conversation n’a pas viré au pugilat, mais les participantes se sont peu à peu emparées de cet outil pour faire vivre elles-mêmes un débat difficile sur les questions de race, d’immigration ou de foi.
Pour le journalisme, une raison évidente d’exister
Cette opération m’est revenue en tête en voyant une brève séquence d’un reportage diffusé jeudi dans Quotidien (et que je n’ai pas retrouvé en ligne). Après avoir repéré un couple d’électeurs de Le Pen venue assister à un meeting de Macron (« pour se faire [leur] propre idée »), le journaliste enjoint les autres personnes présentes dans la file d’attente à dialoguer avec eux.
Quand j’étais étudiant, c’était le genre d’intervention qu’on nous recommandait de ne pas faire : le journaliste ne saurait intervenir sur les événements se déroulant devant lui, pour ne pas sacrifier sa neutralité.
Aujourd’hui, je suis peu à peu convaincu du contraire. Confronté douloureusement à la question de sa propre utilité dans des sociétés hyperconnectées et surinformées, le journalisme tient là une raison évidente d’exister.
Servir de facilitateur pour créer du lien entre l’actualité et sa communauté. Faire preuve de suffisamment d’empathie et de diplomatie pour ne plus se mettre l’opinion à dos. Maintenir à tout prix le dialogue, comme on protège la flamme d’une bougie menacée par un mauvais courant d’air.
« Ils ont compris comment gagner avec des mensonges et ne vont pas s’arrêter là »
Si vous trouvez ça un peu concon comme conclusion, il y a aussi la version coup-de-pied-dans-le-cul de cette thèse. Elle est servie par Jonathan Pie, reporter fictif incarné par le comédien britannique Tom Walker dans une vidéo énervée :
« La seule chose qui marche, putain, c’est d’en avoir quelque chose à foutre, de faire quelque chose, et tout ce que vous avez à faire c’est entrer dans le débat, parler à quelqu’un qui pense différemment et parvenir à le convaincre.
C’est tellement simple, mais pourtant la gauche est devenue incapable de le faire. Arrêtez de penser que ceux qui ne sont pas d’accord avec vous sont des malfaisants, des racistes, des sexistes ou des idiots. Et parlez-leur, persuadez-le de penser autrement, parce que si vous ne le faites pas, le résultat c’est Trump à la Maison-Blanche. »
Parce qu’en face, ils commencent à avoir de l’entraînement, expliquait en substance Rupert Myers, journaliste politique pour le GQ Magazine britannique, toujours à Pérouse :
« Le camp du Leave a beaucoup appris. Ils ont compris comment gagner avec des mensonges, et ils ne vont pas s’arrêter là.
Par exemple, ils vont proposer de faire un référendum sur la privatisation de la BBC. Ensuite, ils vont vous demander pourquoi vous déniez au peuple britannique la possibilité de se prononcer sur ce sujet. Avant que vous ayez eu le temps de réagir, ils vont expliquer qu’on pourrait financer des hôpitaux avec le budget de la BBC…
Tant que les journalistes n’auront pas trouver un moyen efficace de lutter contre leurs mensonges, ils ne s’arrêteront pas. »
Pensez‑y avant de vous lancer dans un « ménage » de votre liste d’amis Facebook !
Hé, ce texte fait partie d’une série de notes consacrée au « journalisme en empathie » ! Voici le menu complet :
- Intro. Les médias n’ont pas besoin de plus de technologie, mais de plus d’empathie
- Episode 1. L’empathie avec l’audience. « Vos lecteurs ne vous demanderont pas des vidéos de chat ou de bébé »
- Episode 2. L’empathie avec les électeurs. « Pourquoi il ne faut pas virer des amis Facebook à cause d’une élection (surtout si vous êtes journaliste) »
- Episode 3. L’empathie avec les sources. « Merci de supprimer l’article me concernant » : le journaliste face à la fragilité de ses sources
- Episode 4. L’empathie entre collègues : Les journalistes ne devraient plus se cacher pour pleurer