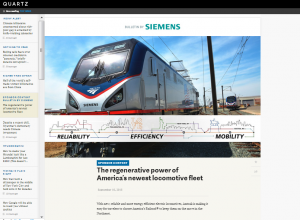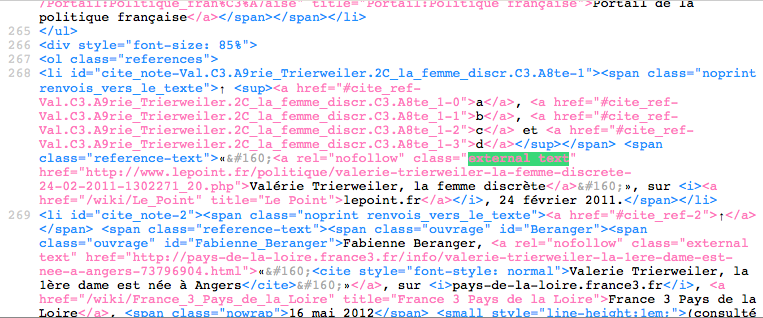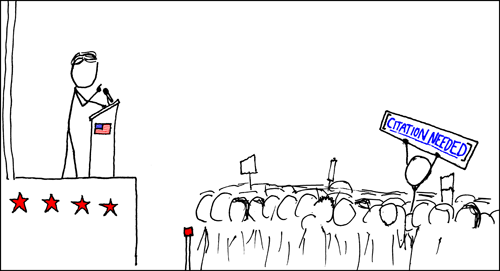50% de femmes derrière la caméra, et 20% seulement devant : ces chiffres, qu’on retrouve d’une étude à l’autre, voire d’un pays à l’autre, montrent l’ampleur de la sous-représentation des femmes à la télévision.
Sur ce thème se tenait un débat passionnant samedi aux Assises du journalisme, à Metz. Voici une synthèse des échanges.
Dominique Fackler (Ina Stats). A la demande du CSA, nous avons travaillé sur la représentation des femmes dans les journaux télévisés, à la télévision (grandes chaînes et chaînes info) et à la radio.
Nous l’avons fait une première fois en 2013, et une nouvelle fois début 2014. Près de 11 000 sujets télé et plus de 2 000 sujets radio ont été analysés.
On s’est intéressé d’abord aux journalistes qui signent les sujets, ce qui permet de mesurer la place des femmes dans les rédactions. Sur un an, elles sont un peu moins présentes à la télé, et un peu plus à la radio. Les plus fortes baisses sont pour Arte et France 2. Dans ce classement, France 3 est en tête, M6 est dernière.
Côté chaînes info, i‑Télé est en forte baisse, de 15 points. Côté radios, la plus forte hausse est pour RMC, la plus forte baisse pour France Inter.
On a cherché à savoir si les femmes journalistes étaient plus présentes sur certaines thématiques. Selon nos chiffres, ce n’est pas le cas mais les angles peuvent être différents, par exemple avec davantage de sources féminines interrogées.
La deuxième partie de notre étude concerne les intervenants, les personnes qui sont interviewées lors de ces journaux télévisé. Pour l’ensemble des médias, il y a moins de 20% de femmes parmi eux, soit une femme pour quatre hommes.
France 3 est en tête avec 23%, Canal+ dernière avec 16%. Côté chaînes infos, le bon élève est I‑Télé : côté radios, c’est France inter.
Quand on regarde qui sont les personnalités féminines les plus interviewées à la télévision, ce sont à 95% des femmes politiques. L’étude a eu lieu au premier trimestre 2014, pendant la campagne municipale, Anne Hidalgo et Nathalie Kosciusko-Morizet sont donc très présentes.
On s’aperçoit que la radio interviewe très peu les femmes. Une seule radio a interviewé plus de trois la même femme sur la période étudiée, c’était France Inter.
Marlène Coullomb-Gully (professeur à l’université Toulouse II). On retrouve ce chiffre de 20% dans d’autres études. C’est une sous-représentation manifeste par rapport aux hommes, puisque les femmes représentent 52% de la population.
Finalement, le média le plus gender friendly, c’est la télévision. Les femmes ont de grosses difficultés à la radio, notamment à cause de la voix. Il y a même eu une période où les journalistes femmes étaient systématiquement retoquées : on considérait qu’une voix féminine n’avait pas assez de légitimité pour présenter les infos à la radio.
Si vous prenez les trois matinales les plus écoutées (France Inter, Europe 1 et RTL), il n’y a jamais eu de femmes à leur tête.
Ruth Elkrief (BFM-TV). France Info a eu Raphaëlle Duchemin et a aujourd’hui Fabienne Sintes…
M. C.-G. C’est vrai, mais pour les autres, c’est plus des matinales, mais des « matimâles ». Mais c’est encore pire en presse écrite, qui est plus focalisée sur la politique et l’économie, thèmes où les hommes sont en position de force.
Il y a une double ségrégation : d’abord verticale, c’est le « plafond de verre » ou « plancher collant » qui empêche les femmes de monter dans la hiérarchie ; ensuite horizontale, ce sont les domaines dans lesquels les femmes se retrouvent assignées.
R .E. Ça change, quand même : la campagne municipale à Paris en est la preuve, avec trois femmes qui s’affrontaient.
Quand on parle des médias, on parle aussi de la capacité à être audible, à passer à l’antenne.
Par principe, je ne fais pas de la discrimination positive. Et quand on trouve des femmes douées, qui connaissent les codes de la communication, qui prennent des risques et ne se limitent pas à langue… alors on va les chercher autant que les hommes.
La question, c’est : est-ce qu’elles osent parler, prendre des risques ? Je me souviens qu’au début, les femmes politiques qu’on invitait ne venaient que si elles considéraient qu’elles avaient quelque chose à dire…
Quand elles venaient, elles étaient très langue de bois, très disciplinées. Ce n’est pas un hasard si la première à avoir explosé médiatiquement, c’est Ségolène Royal, qui accepte de prendre des risques.
Ça va avec la parité au gouvernement : si les femmes ministres osent assumer leur position de pouvoir, alors elles seront plus visibles.
Mais ça change, je m’aperçois parfois qu’en une semaine, j’ai eu à deux ou trois reprises des femmes sur mes plateaux.
M. C.-G. Même quand les femmes ne souhaitent pas mettre en avant le fait qu’elles sont des femmes, les médias les ramènent à leur condition de femmes.
Ça passe par des choses anodines, parfois. On les interroge en tant qu’épouse et mère, alors que les hommes ne sont jamais interrogés en tant qu’époux et père.
On mentionne leur apparence physique, leur robe, leur coupe de cheveux. On utilise le prénom : on parle de « Ségolène », du débat « Ségo/Sarko ». C’est symbolique : le prénom relève de l’espace personnel, privé ; désigner une femme par son prénom, c’est la renvoyer à cette sphère.
Ensuite, il y a cette liste de surnoms « typifiants » qu’on leur accole en permanence : « la pasionaria », « l’égérie », « la madonne », « la Walkyrie », « la muse »… On ramène les femmes politiques à des types.
Enfin, il y a les adjectifs. On dira d’un homme politique qu’il a du caractère, d’une femme politique qu’elle a mauvais caractère. Un homme politique est autonome, une femme politique est incontrôlable – c’est ce qu’on dit souvent de Royal ou de Taubira.
On dit que dans le Panthéon grec, s’il y a beaucoup de déesses, le divin ne s’exprime qu’au masculin. De même, il y a des femmes politiques mais le politique ne s’exprime qu’au masculin.
Annette Young (présentatrice de The 51%, sur France 24). J’ai 51 ans, j’ai vu les choses beaucoup évoluer au sein des rédactions depuis trente ans .
Quand j’ai démarré, j’ai commencé dans l’équivalent du Monde en Australie : aucun rédacteur en chef n’était une femme. Depuis, les changements ont été spectaculaires.
Mais une salle de rédaction reflète l’ensemble de la société. Et journaliste, c’est un métier où il faut disposer de temps, ce n’est pas facile de concilier vies personnelle et professionnelle.
Il faut aussi parler de l’aspect psychologique : les hommes de ma génération s’identifient, fréquentent, s’intéressent surtout aux autres hommes.
Nous sommes des êtres humains, empreints de subjectivité et façonnés par notre milieu, notre éducation.
Le cerveau prend des raccourcis pour se repérer dans le flux d’informations qui l’assaille : il jugera toujours un homme avec des cheveux gris plus crédible que moi, une femme brune. C’est ça, la grande injustice, et c’est ce qui est en train de changer.
Thierry Thuillier (directeur des programmes de France 2). Mon chef de service quand j’ai commencé, c’était Ruth Elkrief, sur TF1… Et à France télévisions, j’ai remplacé une femme [Arlette Chabot, ndlr].
Pour autant, c’est vrai qu’il y a un problème pour les femmes au plus haut niveau de l’encadrement. J’ai nomme des femmes rédactrices en chef (Agnès Vahramian, Agnès Verdier-Molinier). C’est la première fois qu’une femme est en charge du JT de 20 heures sur France 2. C’est dire si on était en retard, c’est spectaculaire alors que ça ne devrait pas l’être.
On a pas mal féminisé aussi les éditorialistes, notre éditorialiste politique est une femme. Ça n’a pas été si simple : pas mal de ces femmes ont eu un premier réflexe de refus, trouvant la fonction très lourde, ne se sentant pas prête pour des raisons familiales. Pour la convaincre, j’ai dit à Agnès : « Moi aussi, j’ai des enfants, moi aussi, je veux rentrer plus tôt du travail pour m’en occuper. »
On enclenche quelque chose. Il faut tracer la route, pour que les femmes prennent leur place. Je suis optimiste : on a mis en place un baromètre en interne pour mesurer la place des témoins et experts femmes, quelque chose assez strict, mais un jour, il deviendra inutile.
On a mis en place cet outil parce que si on se contente de dire « allez, il faut trouver des experts femmes, aller en région, changer nos habitudes » tout le monde acquiesce, et puis tout le monde oublie.
On a donc fixé des objectifs et on fait des points trimestriels avec les chefs. Il faut y aller à marche forcée. Et je précise qu’on n’a pas attendu le CSA pour s’y mettre.
Donna Taberer (BBC). Dans notre rédaction, hommes et femmes sont à 50–50. Dans la hiérarchie, on a quelques directrices, mais la sous-représentation encore forte.
Récemment, une proposition de promotion interne a été publiée, concernant quatre postes. Sur les dix-sept candidats, un seul était une femme. Le responsable du recrutement a refusé d’aller plus loin, et a recommencé la procédure. Finalement, deux femmes ont été prises.
Mais ce n’est pas forcément un problème de sexisme, plutôt le signe que les femmes n’osent pas.
M. C.-G. Une étude réalisée au niveau européen montre que lorsqu’on on monte, le rapport femmes-hommes passe de 50%-50% à 70%-30% pour la hiérarchie intermédiaire et 10%-90% pour le top management.
R. E. A BFM-TV, on est obligés de faire attention à prendre des hommes pour les postes de base… Mais ce sont plutôt des hommes qui sont les patrons, c’est clair. Et les dernières nominations ont été des hommes.
La question, c’est la stratégie de pouvoir des femmes. J’étais le chef de Thierry Thuillier au début de sa carrière, et maintenant il est à un poste plus haut dans la hiérarchie.
Je n’ai pas aimé être chef, j’étais dans un rapport plus hédoniste à mon métier : je voulais me faire plaisir. Je ne me suis pas projetée dans une situation de pouvoir. C’est pourtant ce qu’il faut faire pour l’atteindre et y rester.
Il faut convaincre les femmes qu’elles peuvent avoir le pouvoir, et continuer à avoir une vie personnelle.
Il y a eu une époque de rêve, c’était avec Michèle Cotta, à TF1 ou France Télévisions. Ses chefs de service étaient pour moitié des femmes.
A. Y. Il faut faire du réseautage, profiter des relations. Les femmes s’en veulent souvent de ne pas être assez dures, elles sont dans l’autoflagellation, elles pensent manquer de contacts. Parfois, il faut s’en prendre à nous-mêmes.
La démographie change :en Grande-Bretagne aujourd’hui, beaucoup de quarantenaires ne sont pas mères. Elles s’absentent moins du lieu de travail et pourront être prises pour des postes à responsabilité. Elles seront un vrai cheval de Troie, ce sera déterminant pour la suite, pour la capacité des femmes à s’affirmer.
Ségolène Hanotaux (collectif Prenons la une). Avec 50% de femmes journalistes dans les rédactions, pourquoi a‑t-on 20% d’interviewées seulement ?
M. C.-G. Pendant longtemps, le fait que le journaliste soit une femme n’avait pas d’impact dans le choix des personnes interviewées. Mais récemment, on a vu un infléchissement dans les études : les femmes journalistes commencent à avoir davantage tendance à interviewer des femmes.
C’est le signe que la question des rapports hommes/femmes a été conscientisée : on sait qu’il ne suffit pas d’être une femme pour être féministe.
T. T. Il y aussi des contraintes de temps qui expliquent ce conformisme : pour aller vite, on prend toujours les mêmes, des hommes. Du coup, à France Télévisions, on a travaillé sur un guide des expertes, qui contient 400 noms de femmes experts à disposition des rédactions, avec leur numéro de portable et leur adresse e‑mail. On l’a partagé avec les autres rédactions du groupe.
Ce guide est utilisé, au moins par une partie des journalistes : le combat contre le conformisme, c’est quelque chose qui doit être quotidien.
On a organisé des formations pour la hiérarchie, pour que cette ambition-là soit diffusée. Au début, on a eu beaucoup de mal à faire venir les hommes pour suivre ces sessions.
Mais si on ne fait pas tout ça, on devra passer par la loi, la contrainte, les quotas. Je préfère que ce soit nous qui nous prenions en main.
D. T. Nous avons lancé le programme Expert Women de la BBC Academy parce que nous avions les mêmes chiffres que vous, le plafond de 20%. Maintenant, on en est à trois hommes pour une femme [soit 25% de femmes, ndlr], c’est la preuve que ça peut changer.
On a lancé une chaîne YouTube, un espace sur LinkedIn, on a édité des bases de données, fait des cours solides et approfondis et oui, on a fait un peu de discrimination positive.
Sur les 364 expertes formées à la BBC Academy, 74 ont percé, et sont apparus dans des centaines de reportages.
On leur a demandé ce qui se passait quand un journaliste les appelait avant qu’elles suivent cette formation. Beaucoup refusaient, renvoyaient vers un homme, même s’il était moins expérimenté. Il y a ce syndrome de l’usurpatrice, cette idée qu’un homme sera toujours meilleur qu’elles.
Pour moi, les quotas ne fonctionnent pas : il faut que les femmes expertes se fassent valoir elles-mêmes et feront de même.
T. T. A l’université France Télévisions, on forme les chefs, mais pas les expertes.
S. H. Est-ce que les gens du service des sports y vont ?
T. T. Le service des sports n’est pas sous ma responsabilité, mais je vois très bien à quoi à faire illusion…
R. E. J’ai souvent l’impression que les femmes se disent : « Je suis une élève appliquée, je fais bien mon travail, je n’ai pas besoin de passer à la télé. » Et ben si. Les médias structurent le monde, et vous pouvez avoir du pouvoir.
De mon côté, je me gendarme, je me police, je dis : « Ça fait quinze jours qu’il n’y a pas assez de femmes, c’est pas possible. »
C’est plus simple d’appeler les mêmes mecs : ils sont bons, il savent qu’il faut être clair, pas trop long. Sur une chaîne info, vous devez être percutant, vous devez aller vite. Je suis exigeante, sévère, parfois injuste. Je voudrais avoir davantage d’expertes dans certains domaines, mais je ne les trouve pas assez bonnes.
C’est pour ça que BBC Academy très bonne idée.
A. Y. Il y a un autre blocage : la volonté d’être aimé. Pour une femme, ça veut dire ne pas paraître comme autoritaire ou malpolie. On voit qu’on demande tout et son contraire aux femmes…
Comme présentatrice, c’est très dur de trouver des femmes à Paris qui parlent assez bien anglais et qui se sentent suffisamment en confiance pour passer dans mon émission sur France 24.
Et je me rends compte qu’il faut avoir un encadrement qui pense ces questions-là, qui est conscient du problème et s’en occupe concrètement. La volonté doit venir d’eux. A France 24, on diffuse 24h/24, c’est comme une grosse moissonneuse batteuse, on ne sait pas ce qu’on va diffuser dans une heure, on ne peut pas penser à long terme ?
Du coup, je me demande s’il ne faut pas une obligation légale pour forcer les managers.
A. H. En France, elle existe en partie, d’ailleurs l’objectif du CSA est d’arriver à 30% d’expertes à la fin de l’année, on verra s’il déclenche les sanctions.
D. T. Je pense que les objectifs internes sont meilleurs que les quotas. A la BBC, la politique c’est d’avoir au moins un femme dans chaque station locale et une femme dans chaque émission de divertissement. C’est l’affaire de tous, des salariés lambdas au grand patron.
Mais il faut arrêter de dire que c’est dur, sinon c’est utilisé comme excuse. On est 52%, ce n’est pas si difficile.
T. T. Le PDG de France TV a demandé qu’il y ait au moins une femme candidate quand un poste de direction est ouvert au recrutement. Moi aussi, je préfère que l’ensemble de l’entreprise s’engage.
M. C.-G. D’accord, mais on peut trouver que ça ne va pas très vite. On a hurlé quand la parité a été instaurée en politique ; pourtant, aujourd’hui, personne ne propose de la supprimer, et ça a permis aux choses de bouger. Il ne faut pas être systématiquement opposé à des quotas.
R. E. Pour moi, la sensibilisation est en train de fonctionner. Quand il y a une femme patronne dans une rédaction, elle donne envie, et elle sert de modèle. La compétence est importante, mais avoir des femmes à la tête des médias est important pour les salariées.
Je me souvient d’une phrase du juge Marc Trévidic, qui me rappelait que les femmes sont désormais ultra majoritaires dans la magistrature. « Bientôt il n’y aura plus que des femmes magistrats, donc bientôt il y aura des femmes aux postes plus prestigieux, c’est inévitable. » C’est la même chose pour les rédactions.
Après, le pouvoir réel, ce n’est pas forcément dans un comité de direction paritaire qu’il s’exerce. Parfois, c’est dans une discussion entre mecs dans un bureau fermé, avec un homme politique au téléphone. Je l’ai vécu, et c’est pour ça que je n’ai pas aimé être chef.
Les hommes sont programmés dès le plus jeune âge puis au fil de leurs études à se voir à un haut niveau de pouvoir.
Mais je ne suis pas favorable à une loi, en tout cas pas tout de suite. Laissons sa chance à la sensibilisation. Peut-être que dans cinq ans, j’aurai un autre avis.
D. F. Si on regarde l’évolution entre 2013 et 2014, on voit qu’elle est positive : on est passés de 18,9% à 20,1% de femmes parmi les interviewés pour les chaines généralistes. Pour les chaînes info, il y a stagnation. A la radio, on passe de 16,5% à 17,7%. RTL est en baisse, Europe 1 en hausse de 5 points.
R. E. Pour les invités politiques, c’est plus facile, grâce à la parité. Mais il y a des domaines où on y arrive pas.
Au passage, rappelons que les discriminations qui touchent les entreprises touchent aussi les entreprises de presse : les femmes représentent 54% des CDD et 58% des pigistes, par exemple. […]
Je voudrais revenir sur une chose : quand j’ai Nathalie Kosciusko-Morizet en plateau et que je lui dis : « Vous avez changé de coiffure », je ne considère pas que c’est du sexisme.
M. C.-G. Il faut que vous posiez la même question à Montebourg…
R. E. Quand j’ai reçu Bruno Lemaire, je lui en parlé de sa chemise, qu’il porte ouverte plus souvent depuis qu’il est candidat à la présidence de l’UMP, pour faire plus jeune. C’est aussi une analyse de leur com”.
Dans le public. Avoir plus de femmes journalistes, est-ce que ça change quelque chose au journalisme lui-même ?
T. T. Sur les terrains dangereux, les femmes sont un peu plus déterminées et courageuses. Mais sinon, je ne vois pas de changement.
R. E. Je ne pense pas qu’il y ait un œil féminin sur l’information. Il peut y avoir des approches différentes ponctuellement. Ça me rassurerait qu’il n’y ait pas de généralisation. Il y a une formation, un professionnalisme qui peut se retrouver chez les hommes et chez les femmes.
D. T. Si on ne reflète pas la diversité de l’audience, on perd en audience. Pour la BBC, il ne s’agissait pas que d’avoir plus des femmes, mais aussi d’avoir de nouveaux sujets, des sujets apportés par expertes femmes.
Du coup, on a organisé des rencontres entre journalistes et expertes, et on a donné le numéro de téléphone des premiers aux secondes. Et ça a changé le contenu des informations.
Dans le public. On n’a pas parlé de l’écart de rémunération, qui augmente quand on monte dans la hiérarchie…
R. E. C’est la même chose dans les médias que dans le reste des entreprises. Là, on rentre dans le dur.
M. C.-G. Les femmes négocient moins leur salaire que les hommes, elles vont moins souvent voir leur supérieur hiérarchique. Aux futures journalistes dans la salle, je dis : « Il faut aller négocier votre salaire. » Les femmes pensent souvent qu’elles doivent être reconnues d’elles-mêmes.